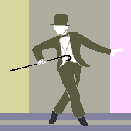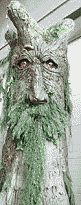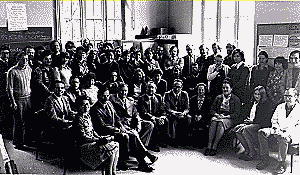|
La
condition humaine est corporelle.
Matière d'identité au plan individuel
et collectif, le corps est l'espace qui se donne
à voir et à lire à
l'appréciation des autres. C'est par lui que
nous sommes nommés, reconnus,
identifiés à une appartenance
sociale. La peau enclot le corps, les limites de
soi, elle établit la frontière
entre le dedans
et le dehors de manière vivante, poreuse,
car elle est aussi ouverture au monde,
mémoire vive. Elle enveloppe et incarne la
personne en la distinguant des autres, ou en la
reliant à eux, selon les signes
utilisés. Le corps est la souche identitaire
de l'homme, le lieu et le temps où le monde
prend chair.
|
Parce qu'il n'est pas un ange,
toute relation de l'homme au monde
implique la médiation du corps. Il
y a une corporéité de la
pensée comme il y a une
intelligence du corps. Des techniques du
corps aux expressions de
l'affectivité, des perceptions
sensorielles aux inscriptions
tégumentaires, des gestes de
l'hygiène à ceux de
l'alimentation, des manières de
table à celles du lit, des modes de
présentations de soi à la
prise en charge de la santé ou de
la maladie, du racisme à
l'eugénisme, du tatouage au
piercing, le corps est une
matière inépuisable de
pratiques sociales, de
représentation,
d'imaginaires.
|

|
Impossible de parler de l'homme sans
présupposer d'une manière ou d'une
autre que c'est d'un homme de chair dont il s'agit,
pétri d'une sensibilité propre. Le
corps est l'" instrument
général de la compréhension du
monde ", disait Merleau-Ponty.
|
L'existence de l'homme implique une
mise en jeu sensorielle, gestuelle,
posturale, mimique, etc., socialement
codée et virtuellement intelligible
par les acteurs dans toutes les
circonstances de la vie collective au sein
du même groupe.
|
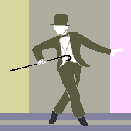
|
La compréhension du
monde est elle même le fait du corps
à travers la médiation des
signes sociaux intériorisés,
décodés et mis en jeu par
l'acteur. " Nous ne réduisons pas
la signification du mot, et pas même
la signification du perçu à
une somme de " sensations corporelles ",
écrit Merleau-Ponty, mais nous
disons que le corps, en tant que qu'il a
des " conduites " est cet étrange
objet qui utilise ses propres parties
comme symbolique générale du
monde et par lequel en conséquence
nous pouvons " fréquenter " ce
monde, le " comprendre " et lui trouver
une signification ". Le corps est un
vecteur de compréhension du rapport
au monde de l'homme. A travers lui, le
sujet s'approprie la substance de son
existence selon sa condition sociale et
culturelle, son âge, son sexe, sa
personne, et la rejoue à l'adresse
des autres.
|
Toute société s'articule
sur un système de sens et de valeurs,
parfois sensiblement différencié s'il
s'agit d'une collectivité divisée en
groupes ou en classes sociales bien
spécifiques. Les acteurs échangent en
permanence des significations sur la base de ces
conventions communes, soumises bien entendu aux
aléas de la création collective.
L'homme fait le monde en même temps que le
monde fait l'homme dans une relation changeante
d'un lieu à l'autre de la condition humaine
à l'intérieur de certaines
contraintes. La nature et ce que les hommes en
attendent n'existe que traduite en termes sociaux
et culturels. A chaque fois cette équation
dessine un univers spécifique. La perception
sensorielle de l'environnement est elle même
oeuvre de culture. Et le corps n'échappe pas
à la règle qui fait de toute chose un
effet d'un tissu social et culturel à
l'intérieur de limites anthropologiques
infiniment variables.
|
Il n'existe pas plus de nature
humaine que de nature du corps, mais une
condition de l'homme impliquant une
condition corporelle changeante d'un lieu
et d'un temps à l'autre des
sociétés
humaines.
|
|
On marche sur le feu au cours
de cérémonies religieuses,
on soigne les brûlures d'un homme ou
même d'un animal, dans nos
régions par exemple, en soufflant
sur les plaies ou en récitant une
oraison consacrée par la tradition
et l'expérience du
guérisseur; on soigne des maladies
en régulant les énergies
perturbées à travers un
contact physique déterminé
de la main ou le recours à des
aiguilles; on négocie avec les
dieux ou on les affronte par
l'intermédiaire de la transe ou de
la possession; on libère d'un
envoutement un homme qui s'acheminait vers
la mort à travers un rite de
désorcellement; de longues
séances où l'on se
prête à la restitution
actuelle de son existence passée
produisent des effets physiques
libérateurs ou pénibles chez
un analysant; on soigne un enfant au bord
de la mort en lui greffant le coeur d'un
autre enfant mort quelques heures
auparavant dans un accident de la route;
par l'action d'une molécule on
calme un homme agité, on dynamise
sa vitalité ou on efface son
angoisse. L'énumération
pourrait longuement se
poursuivre.
|

|
Au fil de l'histoire ou de l'espace ce sont
des multitudes de modèles
d'interprétations de la maladie ou du corps,
ou plutôt des relations entre le monde et
l'homme qui se succèdent sous les yeux du
chercheur attentif et curieux. Il y a quelque
chose d'infini dans l'invention humaine de soigner
et d'interpréter le corps. Les
sociétés humaines construisent le
sens et la forme de l'univers où elles se
meuvent. Et les limites de l'action de l'homme sur
son environnement sont d'abord des limites de sens
avant d'être des limites de faits.
De quel corps parlons nous
en anthropologie ?
Le corps est une réalité
changeante d'une société à
une autre : les images qui le définissent,
les systèmes de connaissance qui cherchent
à en élucider la nature, les
performances qu'il accomplit sont étonnement
variés, contradictoires même pour
notre logique aristotélicienne du
tiers-exclu. Les représentations sociales
assignent au corps une position
déterminée au sein du symbolisme
général de la société,
elles sont tributaires d'un état social,
d'une vision du monde, et à
l'intérieur de cette dernière d'une
définition de la personne.
Le corps est aussi une construction
symbolique. Il semble aller de soi, mais rien
n'est plus insaisissable. La conception la plus
couramment admise dans nos sociétés
trouve son origine dans le savoir
anatomo-physiologique. Elle repose sur une
conception particulière de la personne,
celle qui fait dire au sujet "Mon corps" sur
le modèle de la possession. Cette
représentation s'est construite au fil de
l'histoire occidentale accompagnant
l'émergence de l'individualisme. Le corps
est perçu pour nos sociétés
comme une enceinte du sujet, le lieu de sa limite,
de sa différence, de sa liberté.
Historiquement il est un reste, ce qui demeure
après le retrait en l'homme du cosmos, des
autres et de la division qui fait de l'homme
l'autre de son corps. Mais que le corps soit
l'objet d'une construction sociale et culturelle
parfois dans son identification même (puisque
certaines sociétés ignorent
l'existence d'un corps comme support du sujet) une
anecdote de Maurice Leenhardt l'atteste avec
force.
|
Chez les Canaques la chair de
l'homme emprunte au règne
végétal. Parcelle non
détachée de l'univers qui le
baigne, elle entrelace son existence aux
arbres, aux fruits, aux plantes,
immergée dans un tissu de
correspondances où la chair de
l'homme et la chair du monde
échangent leurs composantes. La
partie dure de l'homme, son ossature est
nommée du même terme que le
coeur du bois, le même mot
désigne les débris de coraux
rejetés sur les plages. Les
coquilles terrestres ou marines servent
à identifier les os enveloppants
tels que le crâne. La chair et les
muscles renvoient à la pulpe ou au
noyau des fruits. Les reins et les autres
viscères portent le nom d'un fruit
qui leur ressemble. Les poumons dont la
forme rappelle celle de l'arbre
totémique des Canaques sont
identifiés sous ce nom. Les
intestins renvoient aux entrelacs de
lianes qui densifient la forêt. Le
corps apparaît comme une autre forme
du végétal ou le
végétal comme une forme
extérieure de la chair. Pas de
frontières décelables entre
ces deux univers.
Leenhardt insiste sur le fait
que la liaison avec le
végétal n'est pas une
métaphore, mais bien une
identité de substance. Il cite
à ce propos de nombreux traits de
la vie quotidienne. D'un enfant rachitique
on dit qu'il " pousse jaune ", pareil en
cela à une racine dont la
sève manque et qui
dépérit. Un vieillard
s'insurge contre le gendarme qui vient
réquisitionner son enfant pour les
travaux des Blancs : " Vois ces bras,
c'est de l'eau ". L'enfant est semblable
à une " pousse d'arbre, d'abord
aqueuse, puis avec le temps ligneuse et
dure ". D'autres exemples se
succèdent. Les mêmes
matières travaillent le monde et
alimentent la chair. En outre dans la
cosmogonie canaque tout homme sait
à quel arbre de la forêt est
lié chacun de ses ancêtres.
L'arbre symbolise l'appartenance au groupe
en enracinant l'homme à sa terre et
en lui attribuant une place
singulière au sein de la nature. A
la naissance de l'enfant, là
où se trouve enterré le
cordon ombilical, on plante une pousse qui
s'affirme au fur et à mesure que
l'enfant grandit. Le mot karo qui
désigne notamment le corps de
l'homme, entre dans la composition des
expressions qui nomment le corps de la
nuit, le corps de la hache, le corps de
l'eau, etc.
|

|
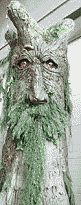
|
Dans la société
mélanésienne que
décrit Leenhardt la notion de
personne structurée au tour du "
moi, personnellement je " de nos
sociétés occidentales est
sans consistance. Si le corps est en
liaison avec l'univers
végétal, entre les vivants
et les morts il n'existe pas davantage de
frontière. La mort n'est pas
conçue par les Canaques sous la
forme de l'anéantissement, elle
marque l'accès à une autre
forme d'existence où le
défunt peut prendre la place d'un
animal, d'un arbre, d'un esprit, ou
même revenir dans le village ou la
ville et se mêler aux vivants sous
l'aspect du bao (p 67sq). D'autre part, de
son vivant, chaque homme n'existe que dans
ses relations aux autres. L'homme n'est
qu'un reflet. Il ne tient son
épaisseur, sa consistance, que dans
la somme de ses liens avec ses
partenaires. L'existence canaque est celle
d'un foyer d'échange au sein d'une
communauté où nul ne peut
être caractérisé comme
individu. L'homme n'y existe que dans sa
relation aux autres, il ne tire pas sa
légitimité de sa seule
personne érigée en totem .
La notion de personne au sens occidental
du terme n'est donc pas repérable
dans la sociabilité et les
représentations sociales canaques.
Le corps n'existe pas, ou plutôt il
n'est pas identifié comme "
réalité " autonome dans la
pensée traditionnelle
canaque.
|
M. Leenhardt, soucieux de cerner
l'apport éventuel de la
société française sur les
mentalités traditionnelles canaques
interroge un vieillard et celui lui répond
à la grande stupeur de l'ethnologue, mais en
ouvrant un champ inépuisable à
l'anthropologie du corps : " Ce que vous nous avez
apporté ", c'est le corps " (p 263). Le
Mélanésien conquis même de
façon rudimentaire à ces valeurs
nouvelles ou déstabilisé dans ses
manières traditionnelles se détache
en partie du tissu de sens qui baignait son
existence, il découvre son corps comme
conséquence de son individualisation qui
reproduit sous une forme atténuée
celle des sociétés occidentales. Les
frontières délimitées par son
corps le distinguent désormais en partie de
ses compagnons. La dimension communautaire, sans
être détruite, se relâche en
partie. Un certain nombre de
Mélanésiens finissent par se sentir
davantage individu, ou sont contraints à
s'éprouver tel même si le passage ne
s'établit pas de manière radicale. Le
rétrécissement vers le Moi qui
résulte de cette transformation sociale et
culturelle amène à une centration
nouvelle sur soi. Durkheim déjà avait
analysé la dimension anthropologique du
corps comme " facteur d'individuation "
.
D'une société à une
autre les images se succède et tentent de
réduire culturellement le mystère du
corps, ou plutôt de la chair qui compose
l'épaisseur de l'homme, elles dessinent en
pointillés un objet fugace, insaisissable,
et pourtant en apparence
incontestable.
La désignation du corps comme
fragment en quelque sorte distinct de la personne,
virtuellement autonome, présuppose une
distinction étrangère à nombre
de communautés humaines. L'anthropologie
biblique ignore elle-même cette césure
entre le corps et la personne. Très
éloigné de la pensée
platonicienne ou orphique, elle n'envisage pas la
condition humaine sous la forme d'une chute de
l'âme dans le corps. " L'hébreu, dit
Claude Tresmontant, est une langue concrète
qui ne nomme que ce qui existe. Aussi n'a-t-il pas
de mot pour signifier la " matière ", pas
plus que pour le " corps ", puisque ces concepts ne
visent pas réalités empiriques,
contrairement à ce que nos vieilles
habitudes dualistes et cartésiennes nous
portent à croire. Personne n'a jamais vu de
la " matière ", ni un " corps ", au sens
où le comprend le dualisme substantielle " .
Dans l'univers biblique l'homme est indissociable
de la chair qui le met au monde.
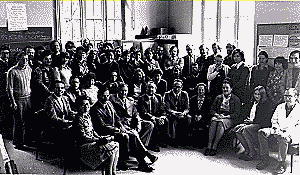
|
Dans les sociétés de
type communautaire, à composante
holiste, où la signification de
l'existence humaine marque une
subordination relative au groupe, au
cosmos, le corps en principe n'existe pas
comme frontière rigoureuse, il
n'est pas l'objet d'une
scission.
Le corps comme
élément isolable de la
personne n'est pensable que dans des
structures sociales de type individualiste
où chacun est séparé
de l'autre et relativement autonome dans
leurs initiatives, leurs
valeurs.
|

|
Le corps fonctionne à la
manière d'une borne frontière pour
distinguer chaque individu. Et le visage est alors
le marqueur privilégié de la
différence intime. L'isolement du corps au
sein des sociétés occidentales
témoigne d'une trame sociale où
l'homme est coupé du cosmos, coupé
des autres et coupé de lui-même. La
distinction du corps et de la présence
humaine est l'héritage historique du retrait
conjugué dans la conception de la personne
de la communauté (les autres) et du cosmos
et l'effet de la coupure opérée au
sein même de l'homme. Facteur d'individuation
au plan social, au plan des représentations,
le corps est dissocié du sujet et
perçu comme l'un de ses attributs. Le corps
devient un avoir, un double. Dans nos
sociétés occidentales le
déploiement du vocabulaire anatomique qui
accompagne la progression des dissections
anatomiques est révélateur d'une
vision du monde où la personne est
refermée sur elle même, il ne trouve
nulle référence hors de lui
même, nulle racine hors de sa sphère,
sinon parfois justement pour nommer tel individu
ayant mis en évidence telle structure
organique. Il traduit également la rupture
ontologique entre le cosmos et le corps. Le corps
de la modernité, celui qui résulte du
recul des traditions populaires et savantes
médiévales et de l'avènement
de l'individualisme occidental marque la
clôture du sujet sur lui-même, son
affirmation d'existence aux yeux des autres. Le
corps occidental qui identifie l'individu est un
interrupteur, il autorise l'énonciation de
la différence individuelle. A l'inverse dans
les société holistes le corps est
relieur, il unit l'homme au groupe et au cosmos
à travers un tissu de correspondances. Les
conceptions culturelles qui disent le contenu
physique de la personne font la même
matière de la chair de l'homme et de la
chair du monde. Il y a une sorte de porosité
de la personne au monde qui l'entoure,
contrairement à l'individu occidental clos
dans son sentiment d'identité, bien
délimité dans son corps .
|
La pluralité des
médecines répond à la
pluralité sociale et culturelle
d'un monde dont chaque
société, chaque groupe,
propose sa version.
|
|
Les thérapeutes et les usagers
bricolent avec ces propositions, s'en accommodent
ou les modifient selon leurs représentations
et leurs trajectoires propres. Le corps, la
souffrance, la maladie, les soins sont autant
d'interrogations dont la réponse n'est pas
moins infinie que la question. Les
systèmes thérapeutiques sont nombreux
et témoignent de modalités
différentes d'efficacité et
d'universalité. Ils offrent des
modèles variés, contradictoires,
insolites, qu'il convient de comprendre dans leur
singularité sociale et culturelle et leurs
aspects anthropologiques. Les
sociétés humaines construisent la
signification et la forme de l'univers où
elles se meuvent. Les limites de l'action de
l'homme sur son environnement sont d'abord des
limites de sens, avant d'être des limites
objectives. Tout système symbolique commande
un système d'action sur l'environnement, ou
sur l'homme lui même, et nourrit des
efficacités collectivement attendues,
notamment dans la prise en charge de l'homme
malade. La nature est toujours transformée
en donnée culturelle, en terrain d'alliance
et d'action pour une société ou un
groupe donnés, dans une époque elle
même délimitée. Dans les
systèmes thérapeutiques, des
représentations particulières du
corps et du mal sont mises en oeuvre pour
étayer des pratiques visant à
soulager ou à guérir. Selon son
écosystème et son organisation
propres chaque société élabore
des dispositifs à l'usage de ses membres,
dont la mise en oeuvre échoit à un
thérapeute accrédité par le
groupe. Les efficacités
thérapeutiques sont plus ou moins agissantes
selon leurs visions du monde et leurs
modalités d'emploi, les troubles
recensés, selon les circonstances de la
rencontre entre celui qui souffre et celui qui
prétend le guérir, et selon la
disposition du groupe à l'égard de ce
système.
Le barreur de feu des campagnes
européennes guérit les brûlures
en murmurant une prière et en effectuant
quelques gestes sur la zone brûlée. La
douleur s'estompe et la blessure disparaît
les heures suivantes sans laisser le plus souvent
la moindre cicatrice. Le barreur agit de la
même façon sur un animal
brûlé. L'observation étonne
celui qui voudrait obstinément maintenir un
cadre de pensée bio-médical car alors
l'action du barreur est impensable et en
conséquence jugé impossible. En fait
le savoir bio-médical et le savoir-faire du
barreur ne se réfutent pas mutuellement, ils
sont d'un ordre différent. L'un et l'autre
ne visent pas le même "corps". Et des
collaborations existent parfois entre l'un et
l'autre, le médecin recourant parfois
(même des hospitaliers) au barreur. Le
pansement de secret ou le désenvoutement
coexistent au sein de la même
société avec la médecine de
pointe car ce sont des pratiques culturelles
intéressant des réalités
distinctes, mobilisant des usagers dont les
demandes, mais aussi les références
sociales et culturelles différent. Entre eux
il n'y a pas progrès, mais différence
de vision du monde, différence
d'application.

|
Pas plus que les diverses
médecines occidentales ne
s'annulent entre elles.
L'homéopathie ou la médecine
allopathique, l'ostéopatie ou la
chiropractique, ou encore l'acupuncture,
pour prendre ces seuls exemples,
témoignent chacune d'une
interprétation propre du corps et
de la maladie, elles mettent en oeuvre des
thérapeutiques spécifiques,
mais toutes participent d'une certaine
vérité du corps ou de la
maladie. Simplement leurs applications et
leur universalité diffèrent,
de même les conditions de leur mise
en oeuvre, leur efficacité, les
pathologies traitées. Les savoirs
populaires encore observables aujourd'hui:
panseurs de secret, magnétiseurs,
radiesthésistes,
phytothérapeutes, barreurs,
rebouteux ou autres, nous rappellent
également la dimension symbolique
du corps humain. Le symbolique
étant toujours la forme
d'apparition du réel pour la
condition humaine. Aucune médecine
n'est la restriction de l'autre, mais
seulement une voie possible d'accès
au corps et à la souffrance par
l'intermédiaire de la relation
thérapeutique.
|
|
On oublie souvent
l'absurdité qu'il y a parler du
corps à la manière d'un
fétiche, c'est-à-dire en
omettant l'homme qu'il
incarne.
|
Il faut dire l'ambiguïté
d'évoquer la notion d'un corps qui
n'entretient plus que des relations implicites,
supposées, avec l'acteur dont il fait
pourtant indissolublement corps. Tout
questionnement sur le corps exige au
préalable une construction de son objet, une
élucidation de ce qu'il sous-tend. Le corps
n'est-il pas pris lui même sous le voile des
représentations. Le corps n'est pas une
nature. Il n'existe même pas. On n'a jamais
vu un corps: on voit des hommes, des femmes. On ne
voit pas des corps. Dans ces conditions le corps
risque fort de ne pas être un universel. Et
la sociologie ne peut prendre tel quel un terme de
la doxa pour en faire le principe d'une analyse,
sans en saisir au préalable la
généalogie, sans élucider les
imaginaires sociaux qui le nomment et agissent sur
lui, et cela non seulement dans ses connotations
(la moisson des faits analysés par les
sociologues est riche en ce domaine), mais aussi
dans sa dénotation, rarement
questionnée. Le corps n'est pas une nature
incontestable, immuablement objectivé par
l'ensemble des communautés humaines,
d'emblée donné à l'observateur
qui peut le faire fonctionner tel quel dans son
exercice de sociologue. Le "détour
anthropologique" (G. Balandier) nous rappelle
l'évanescence de cet objet, en apparence si
tangible, si accessible à la
description.
La
désignation du corps, quand elle est
possible, traduit donc un fait d'imaginaire
social.
D'une société à une
autre se succèdent des images qui tentent de
réduire culturellement le mystère de
l'incarnation de l'homme. Une myriade de
représentations dessine en pointillé
un objet fugace, insaisissable et pourtant en
apparence incontestable. Mais la formulation du mot
"corps", comme fragment en quelque sorte autonome
de l'homme dont il porte le visage
présuppose une distinction
étrangère à nombre de
sociétés. Pour beaucoup de
sociétés traditionnelles, à
composantes communautaires, la personne ne fait pas
l'objet d'une scission et elle est de
surcroît, dans les représentations
collectives, mêlée au cosmos, à
la nature, aux autres. Le corps n'est pas
distingué de la persona et les mêmes
matières premières entrent dans la
composition de l'homme et de la nature qui
l'environne. Dans ces conceptions de la personne on
ne coupe pas l'homme de son corps, comme l'envisage
couramment le sens commun occidental.
Le corps, en tant
qu'élément isolable de la personne
à qui il donne son visage, ne semble
pensable que dans les structures
sociétales de type individualiste
où les acteurs sont séparés
les uns des autres, relativement autonomes dans
leurs valeurs et leurs initiatives. Et le corps
fonctionne là, en effet, à la
façon d'une vivante borne frontière
pour délimiter face aux autres la
souveraineté de la personne.
A l'inverse, dans les sociétés
de type traditionnelle et communautaire,
où l'existence de chacun se coule dans
l'allégeance au groupe, au cosmos, à
la nature, le corps n'existe pas comme
élément d'individuation, comme
catégorie mentale permettant de penser
culturellement la différence d'un acteur
à un autre, puisque personne ne se distingue
du groupe, chacun n'étant qu'une
singularité dans l'unité
différentielle du groupe. A l'inverse
l'isolement du corps au sein des
sociétés occidentales (lointain
écho des premières dissections et du
développement de la philosophie
mécaniste) témoigne d'une trame
sociale ou l'homme est pensé coupé du
cosmos, coupé des autres et coupé de
lui même.
|