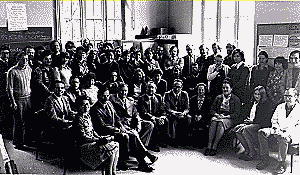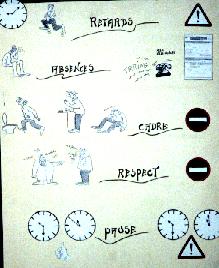|
Les
responsables de l'école se fondent sur le
postulat d'éducabilité, que P.
Meirieu a mis en exergue ; elle est l'affirmation
selon laquelle l'homme n'est pas enfermé
dans sa nature pulsionnelle mais capable de
la dépasser , de la transformer pour
s'humaniser; elle serait reconnaissance de
l'homme comme potentialité, comme sujet du "
ne pas encore " ( J.B. Paturet in Questions
pédagogiques, Hachette éducation,
1999, p. 164). Ce postulat
d'éducabilité s'accompagne
nécessairement d'une
responsabilité éthique pour
l'éducateur.
Or l'éthique, c'est pour Ricoeur "
l'interrogation sur le sens de ses actes " ;
elle nous engage en tant que porteurs de questions
essentielles sur le sens de ce que nous faisons
là où nous avons choisi d'être,
et singulièrement quand nous travaillons
avec des jeunes . " On entre en éthique
quand, à l'affirmation pour soi de la
liberté, s'ajoute la volonté que la
liberté de l'autre soit. Je veux que ta
liberté soit " écrit Ricoeur ( Avant
la loi morale : l'éthique in Encycl. Univ.,
1985, p.42) . Il en va donc d'une éthique de
conviction où l'autre, et en particulier
l'enfant et l'adolescent, sont vus comme sujets
porteurs de potentialités qu'on se doit
d'aider à dévoiler. Sans cette
espérance, sans ce pari sur l'avenir - qui
ne nie pas les obstacles - il n'est point
d'éducabilité. Or, et J. B. Paturet
le montre bien,
|
les
éducateurs que nous sommes se
trouvent dans une position paradoxale
puisque nous avons à la fois
à tenir compte de la
singularité de l'enfant, de sa
parole et de son désir, et à
l'introduire dans la société
avec ses normes et ses valeurs. A
l'articulation de la morale prescriptive
et de l'éthique qui " délie,
dénoue les habitudes, brise moule
et modèle " ( Paturet, op. cit.,
p.166) , l'éducation est un champ
d'une complexité et d'une
difficulté telles que nous ne
pouvons plus nous dispenser d'une
réflexion collective pour la penser
, c'est-à-dire en prendre la
mesure.
|
|
Dans un établissement
scolaire, nous ne pouvons négliger,
au sein de l'équipe
éducative - administrateurs et
enseignants - de nous interroger sur nos
présupposés,
c'est-à-dire sur les
références théoriques
et éthiques qui sont au
fondement de nos actes. Nous ne le faisons
guère, sans doute parce que nous
savons que ces références
diffèrent selon les personnes, leur
éducation et leur histoire
personnelle et qu'elles sont source
d'affrontement et de conflit. Les uns
sont pour l'ordre et la soumission
à l'autorité, les autres
veulent privilégier le
déploiement de la liberté
des élèves, d'autres ne
savent pas trop et s'en remettent aux
modes . De ce non-dit, il
résulte des divisions, une
formation de clans et une suspicion
généralisée qui nuit
aux échanges vrais.
|
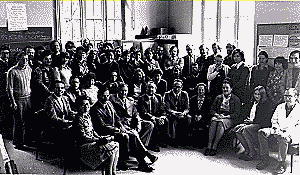
|
Pour que la confiance sous-tende la
communication, une parole vraie doit circuler entre
les adultes - à l'intérieur et
à l'extérieur de
l'établissement - et par voie de
conséquence, entre les adultes et les
jeunes. C'est pourquoi il est indispensable - et
c'est là que le rôle du directeur est
essentiel - de nommer ce que nous souhaitons
partager en tant qu'éducateurs
rassemblés pour une tâche commune.
Qu'est-ce que nous visons ensemble ? Quel
est notre horizon commun, dans quelles
finalités s'inscrivent nos actes et quels
principes orientent ces finalités ? Les
principes - mot ringard et galvaudé - c'est
ce qui est premier ( princeps) , c'est ce qui nous
fait courir, ce qui nous anime en tant qu'adultes
responsables et ce qui nous a par exemple
déterminés partiellement à
choisir le métier d'instruire et
d'éduquer les jeunes. Je me
réfère là à Charlotte
Herfray et à son livre La psychanalyse hors
les murs (Desclée de Brouwer, 1994)
où elle regroupe sous les principes les
valeurs et les théories de
référence . Qu'est-ce qui vaut
pour moi ? Qu'est-ce qui a le plus de prix
à mes yeux et que je ne veux pas sacrifier?
Est-ce l'humain et son développement,
d'où le respect inconditionnel à
l'égard des jeunes , la
responsabilité de leur devenir et le devoir
d'accompagnement, de solidarité, y compris
avec les plus petits, les plus démunis, les
plus en échec ? Ou est-ce mon seul plaisir,
ma réussite individuelle, mon prestige, mon
pouvoir?
Et puisque j'ai choisi le métier
d'éduquer, sur quelles théories de
l'enfant, de l'apprentissage et de l'enseignement
est-ce que je me fonde pour proposer telle
méthode ou telle technique ? Quelle part
est-ce que j'accorde à l'affectivité
dans le développement de l'intelligence ?
Suis-je du côté des rationalistes,
des cognitivistes qui ne se soucient que
d'intelligences ou est-ce que je tiens compte de la
globalité de l'élève
qui est aussi un enfant, un adolescent inscrits
dans une histoire psycho-sociale complexe
?
Il me semble que les chefs
d'établissement doivent être au clair
de cela et proposer à leurs collaborateurs
un tel questionnement inaugural. Ce sont les
questions qui rassemblent, alors que les
réponses divisent. Une équipe
commence à naître lorsque ses membres
sont sollicités à
réfléchir autour d'une interrogation
porteuse de sens, à la fois pour chacun et
pour le groupe.
Le sens, c'est la signification, mais aussi
la direction dans laquelle on va s'engager, la
vision que l'on a de la marche de
l'établissement . C'est pourquoi il revient
ensuite au responsable de l'équipe, lequel a
pouvoir de décision, d'indiquer la direction
qu'il entend suivre, au nom de
l'éthique qu'il souhaite partager et
faire vivre. " La visée éthique ",
pour reprendre les termes de Ricoeur, c'est " la
visée de la vie bonne avec et pour autrui,
dans des institutions justes ".
|
Une " bonne " école, ou du
moins " suffisamment bonne " pour rester
dans l'humilité de Winnicott, je
dirais que c'est celle qui n'est
" ni
jungle, ni caserne
",
comme disait F. Oury, mais "
chantier
de
construction
" ; construction de projets
d'apprentissage individuel et collectif ,
construction d'identité personnelle
mais aussi de socialité et de
solidarité
intergénérationnelle, en un
mot chantier d'humanité dont la
responsabilité de le lancer revient
à l'équipe de
direction.
|
|
Trouver un
chemin praticable en direction
d'autrui
Si on se situe dans une
éthique du respect d'autrui, et
dans la visée " de la vie bonne
avec et pour autrui dans des institutions
justes " , on ne peut qu'humaniser le
pouvoir, c'est-à-dire le partager
avec les membres de l'équipe
éducative. Le partager, en
recourant à des
médiations pour rompre le face
à face trop souvent source de
violence.
La première des
médiations est celle de la
parole que l'on propose de partager
dès le début de
l'année, à
l'intérieur d'un cadre explicite,
un cadre constitué de
règles comme celles de la
confiance mutuelle et du respect
inconditionnel d'autrui, celle du
non-jugement des personnes et celle de la
solidarité dans la recherche.
Ces règles fortes
dérivent des valeurs auxquelles on
croit, elles demandent à
être énoncées et
pourquoi pas écrites solennellement
sur un mur de l'établissement , -
comme le Codex du Vème
siècle avant Jésus-Christ
que l'on peut encore admirer aujourd'hui
sur un mur du Palais de Gortyn en
Crète - . Les valeurs que l'on
partage et les règles que l'on
s'engage à respecter dans
l'établissement , mais aussi
dans les rapports avec les parents,
constituent une référence
commune, elles sont entre nous comme un
signe de ralliement qui contribue à
l'émergence d'une communauté
. Il convient pour cela que les
responsables ne cèdent pas sur
l'éthique, sur la loi
exprimant les interdits fondamentaux,
qu'ils veillent à la
sécurité affective de ses
membres les plus jeunes et les aident
à se sentir contenus et à se
civiliser.
|
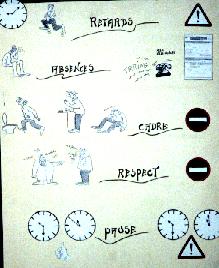
|
Ainsi la loi, qui triangule la relation
et incite au parler clair, au parler vrai, à
condition d'être explicite, favorise la
circulation de la parole à tous les niveaux.
Dès lors, on peut mettre en place
d'autres dispositifs de parole pour les
élèves, les enseignants et les
administratifs, comme par exemple les
groupes de Soutien au Soutien
élaborés par J. Lévine : on y
pense ensemble et avec l'aide d'un psychanalyste,
les difficultés rencontrées dans
l'exercice du métier pour essayer de
comprendre leur origine et pour les dépasser
. Quand au nom d'une éthique du sujet
singulier, on se réclame de ce qu'on peut
appeler un leadership de type démocratique
ou coopératif, on peut inventer aussi
d'autres structures pour créer un lien
social d'établissement, un sentiment
d'identité collective positif ainsi que le
proposent J. Lévine et M.-D.
Pierrelée dans "Je est un autre". Pour un
dialogue pédagogie-psychanalyse ( J.
Lévine, J. Moll, ESF, 2001). Une charte
d'établissement, l'exercice de
responsabilités, des instances de
régulation, d'aide au travail personnel et
de ce que M.-D. Pierrelée a nommé "
l'atelier de réparation des liens
cassés" dans son collège
expérimental du Mans médiatisent les
relations et permettent à tous de se sentir
en sécurité pour mieux travailler et
contribuer à instaurer plus
d'humanité .
Il reste qu'en dépit de notre
bonne volonté, et en raison de l'immense
complexité des relations humaines, les
malentendus et les conflits sont
inévitables, en conséquence de
quoi il nous faut apprendre à les accepter
comme l'expression de la vie , apprendre à
les désigner alors que la peur pousse le
plus souvent à les nier ou à les
éviter, apprendre à les traiter ,
à en analyser l'objet pour tenter de les
dépasser et les résoudre ; cela
revient à déposer les armes pour
s'asseoir à une même table et oser
affronter ensemble la
complexité.[...]
Une éthique de
l'altérité
Il ne vous aura pas échappé
que mes références se situent du
côté de la psychanalyse et de
l'éthique de l'altérité
qui la sous-tend, mais aussi du côté
de la sociologie du sujet et de l'anthropologie
qui s'interrogent sur la place de l'homme dans le
monde, sur les obstacles qu'il rencontre et
doit franchir pour la conquête de sa
dignité . En regard du
déchaînement de violence auquel nous
assistons de plus en plus dans nos cités, et
malheureusement aussi à l'école qui
est une chambre d'écho de la
société , et chez des enfants de plus
en plus jeunes, nous ne pouvons plus fermer les
yeux sur les conditions qui la favorisent ni sur la
souffrance intrapsychique de ceux qui y recourent.
Se référer à une
éthique de l'altérité, c'est
essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour rencontrer les jeunes là où ils
sont , en se gardant de les étiqueter, de
les stigmatiser, de les juger, eux et leurs
familles - ce qui ne nous dispense pas de juger ni
de condamner leurs actes
répréhensibles - c'est chercher avec
eux et non pour eux, des occasions de retrouver de
la valeur, de l'estime de soi, de rebondir dans la
vie et de se reconstruire, de se réparer.
C'est savoir intimement l'importance du regard
d'autrui pour la construction psychique du petit
d'homme, savoir la complexité du
développement des relations intersubjectives
, et surtout l'importance de la parole et de la
dynamique inconsciente du désir.
Des difficultés
d'incarner l'éthique au
quotidien
Se référer à une
éthique du rapport à l'autre, c'est
se situer dans une visée de " vie bonne
",avec d'autres, mais c'est aussi
reconnaître l'existence de notre moi
divisé, conflictuel, qui veut le bien
mais fait le mal, parce que le moi, tiraillé
par un ça pulsionnel, " n'est pas
maître dans sa maison " . C'est
reconnaître humblement que, tout adultes que
nous croyons être, nous ne cessons
d'être travaillés souterrainement par
un inconscient qui nous gouverne à notre
insu, d'où la nécessité,
surtout quand nous sommes responsables d'une
équipe ainsi que d'enfants et d'adolescents,
de connaître un peu mieux les
pièges qui nous menacent.
Le
poids du passé
Nous sommes inscrits, depuis les
débuts de notre vie, dans une histoire
intersubjective de liens à autrui qui
nous ont marqués de leur empreinte. Le
rêve parental, la façon dont notre
venue au monde a été accueillie
émotionnellement, la façon dont
nous avons été parlés,
regardés, portés par autrui, - la
mère et le père essentiellement -
, mais aussi notre sexe, notre place dans la
fratrie, nos expériences de frustrations,
les identifications et désidentifications
à des proches que nous avons pris comme
modèles ont déterminé
partiellement nos attitudes relationnelles .
Même si nous nous en défendons,
nous sommes pris à notre insu dans une
histoire familiale qui a souvent ses ombres
et ses secrets et qui nous a parfois
aliénés. Face au père et
à la mère, au milieu des
frères et sœurs, il a fallu se
profiler ou au contraire plutôt se faire
tout petit et même invisible. Certes des
rencontres ultérieures et des
expériences multiples permettent de
remodeler sans cesse des traits de la
personnalité, mais l'enfance , le temps
par excellence des expériences
primordiales et fondatrices, continue
d'être prégnante au fond de chacun
et de resurgir si nous n'y prenons pas garde.
[...]
Les
pièges du pouvoir.
Pour qui occupe un poste de
direction, (mais aussi pour tous enseignants) la
question du pouvoir se pose immanquablement :
le pouvoir n'est jamais un objet neutre.
Nous pouvons le voir à propos de la
naissance du projet d'enseigner ou
d'éduquer et à plus forte raison,
de diriger un établissement. Le
pouvoir est lié au statut ,
c'est-à-dire à la place
réelle que l'on occupe dans une
institution , et il est en même temps
chargé d'imaginaire. C. Herfray
écrit que " certains sont habités
par le fantasme qu'on naît chef. Comme si
les chefs étaient d'une pâte
différente de la nôtre . Notre foi
en l'autorité nous aveugle " ( op. cit. ,
p. 212). Il importe en tout cas d'être au
clair du pouvoir que l'on a et du rôle que
l'on veut jouer, le rôle faisant
apparaître l'impact de la
subjectivité dans le fonctionnement du
système . Le pouvoir qui est une
réalité institutionnelle implique
une responsabilité à
l'égard d'autrui et donc un
questionnement sur la façon de l'exercer.
Est--t-on plutôt du côté du
modèle paternaliste, très
directif et donneur de leçons, ou bien du
modèle maternant qui
surprotège et parle volontiers à
la place de l'autre, créant ainsi une
dépendance qui flatte notre fantasme de
toute-puissance? Qu'est-ce qui nous a
déterminé à briguer le
pouvoir ? Pour en faire quoi ? Il nous faut
savoir que si on le garde pour soi seul, on est
vite amené à le rigidifier et
à en faire un usage abusif, voire
arbitraire aux dépens de la
liberté d'autrui qui ne peut que se
rebeller. A l'opposé, si on craint
l'usage du pouvoir, si on le nie ou si on est
dans l'ambivalence, on s'arrange pour ne pas
prendre position, on recourt à des
stratégies d'évitement , on recule
devant toute décision, et l'anarchie
s'installe. La question est bien de savoir
comment occuper sa juste place , comment jouer
son rôle sans s'y identifier , sans abuser
du pouvoir que l'on détient, d'une part,
et sans démissionner, d'autre part.
[...]
|