|
Une chose est commune
à tous les jeunes :
ils agissent
avant de parler, ils sont sur leur planète,
dans leur monde, ils veulent du pèse et des
meufs, être flashion, être des
mecs… Bref, certains sont plus formatés
par l’écran de la télé,
les séries Américaines, MCM Pop et la
console Nintendo qu’élevés par
leurs parents…Quand ceux-ci ploient sous leur
propre malheur ou leur acharnement au travail.
Comme pour cette question d’objet, ne croyez
pas que je fais une critique de la
télé, je vous pose une vraie
question, celle des identifications du sujet
envahi par les écrans d’images qui
bougent, et dans lesquelles il prend sans le
savoir, en deçà des mots, les images
de son corps et de son être.
|
En
fin de mon livre « Le deuil de
l’Autre » je découvrais
cette évidence avec laquelle le
travail des « psy » comme des
praticiens sociaux (et des enseignants)
doit faire. Un homme ne devient pas homme
dans un monde où la communication
circule via les images qui bougent,de la
même manière que dans un
monde où l’entrée vous
était médiatisée par
un ancien prêtre, curé,
maire, instituteur,
médecin…
|
Un être
humain, pas une machine à regarder qui
parle. La réalité sociale pour
l'enfant est aujourd’hui d’abord
virtuelle le plus souvent avant
d’être humaine. Ne se voit-il pas
d’abord dans l’écran plus que dans
le miroir du regard de ses parents ? Il se voit ;
il est celui qui est dans le carré
magique.
|
L’image
provoque en lui des sensations de sons et
de couleurs que la réalité
peinera toujours à lui donner. Il
agit avant de pouvoir penser ce qui lui
arrive. Il est touché affectivement
par des sentiments que le plus souvent il
n’as pas vécus… Il est
seul en lui–même dans cette
image de l’homme dont il est
fasciné, qu’il est et que pour
certain nul autre ne vient contredire ou
entamer.
|
Dans
ce contexte, la relation d’objet prend toute
son importance, soulignant la véritable
résolution anthropologique que nous font
vivre ces nouvelles technologies, créant un
monde où l’homme ne devient pas un
homme, où l’homme ne fabrique pas de
l’humain par les mêmes voies imaginaires
de la société d’avant cette
ère du numérique.
Transmission des questions
de l'humain
|
|
N’est-ce
pas à nous, praticiens de
l’homme social,
d’inventer et
d’élaborer, de mettre
à disposition ces nouveaux
chemins d’oedipisme, de
transmission des questions de
l’humaine condition, si
nécessaires aux
adolescents pour sortir de
l’aliénation aux
liens illusoires que notre
civilisation a
produit?
La
culture s’élabore
à travers les productions
d’objets, objets de
reconnaissance dans lesquels
chacun se mire et voit
l’autre. Regard
croisé qui alimente un jeu
de rôle entre Europe et
Afrique au travers des
fétiches, totems pour
l’un, image publicitaire
pour l’autre. De là,
une confusion de
représentations où,
au nom de la modernité,
l’éphémère,
l’auto-engendrement,
l’original
s’opposeraient à
tradition, l’originel
ancestral, le culte des
anciens.
|
|

|
Les enfants du
ciel, happés par ici maintenant du
consumering, voient leur accès à la
condition humaine passer par les paradigmes de
l’image publicitaire. La chose
médiatique leur préfabrique les
modèles existentiels contemporains.
Certains, croyant échapper à la
contingence généalogique, en tirent
la jouissance d’une maîtrise hors
transcendance. Pris dans la fascination du
miroir télévisuel comme espace de
lien social, cette éjection de la
filiation les conduit à de réelles
souffrances. Faute d’une mort inscrivant le
sens de la vie, ces souffrances
s’alimentent d’une violence
persécutrice par manque d’objets
à partager entre jeunes et
vieux.
De nouveaux objets
transculturels?
Cette
rupture est-elle le symptôme d’une crise
de civilisation ouvrant sur de nouvelles formes
d’affiliation? Par quels chemins
s’effectuent ces transformations? Au Nord
comme au Sud, à travers le monde, se
fabriquent ces nouveaux objets
transculturels.
L’homme
est le seul animal à produire un savoir sur
sa propre nature. Si tant est qu’il parle,
avec l’invention de sa parole, il ne peut pas
faire autrement que de s’autoproduire, que de
s’auto-penser.
Chacun de nous
en reçoit de l’Autre les savoirs sur
son être singulier et collectif. Chacun de
nous s’en fait ou non sujet, dans ou hors sa
culture.
Afrique et
Occident
|
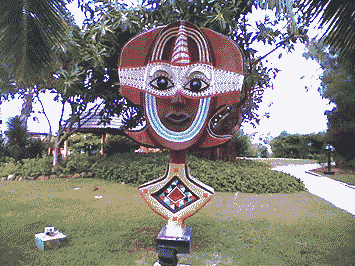
|
|
Les
modalités culturelles
à travers lesquelles
l’homme se produit comme
tel, sont radicalement
différentes entre
l’Afrique et
l’Occident.
En
Afrique, le savoir
s’apprend parmi les
frères au nom des
ancêtres morts qui
détiennent
l’être de
l’individu. Les groupes sont
organisés dans les langues
pour ne pas laisser de prise aux
combats rivalitaires des
frères, dont la mise est
cruciale pour la transmission de
ce que c’est
qu’être un homme ou
pas. Les totems font figure
d’immuables.
En
Occident, le savoir
s’apprend du Père;
pour qu’y naisse le sujet
d’une parole dont il est
sensé être
responsable.
Les
figures de l’Idéal,
qui n’existent pas en
Afrique, au niveau de ce que
l’homme devrait toujours
améliorer la situation de
ses sens, ces idéaux sont
des objets au potentiel
d’autant plus ravageur, que
figurant l’homme, ils ont
force de loi dans la
langue.
|
|
Processus de
désaffiliation
|
Dans
une société où
l’homme se construit malgré
lui au travers des images mouvantes dont
il se vante, nous sommes, à la
lumière de cette lecture,
amenés à penser que le
malaise du sujet dans notre civilisation
n’est pas là où on le
croit.
Certes
les anciennes coutumes sont en
décrépitudes. Mais
c’est moins la perte de ces
repères et traditions qui
déshumanisent nos enfants dans les
villes, que le processus massif de
désaffiliation mis à
l’œuvre du fait de
l’absence de lecture des
légitimités contemporaines
qui se sont inventées. Les jeunes
acceptent quelques autorités quant
aux savoirs sur l’homme, mais ce ne
sont pas celles d’antan, ce sont
celles des lieux qui les touchent en
masse, ces lieux "nouveaux " de la
civilisation et de la langue que sont les
médias d’images mouvantes :
cinéma, presse et
télévision. Parmi eux, la
publicité fait figure
d’icône sans transcendance,
où l’être de
l’homme est érigé dans
la possession des objets comme marque de
valeur exclusivement comptable.
L’idée de bien ou de mal y est
réduite aux affres des joies et
souffrances individuels. Par excellence,
la publicité comme processus
iconique itératif, est les lieux
envahissants et anonymes d’où
les enfants tirent leurs réponses
sur l’humaine condition rivée
aux jouissances du corps par le moyen des
objets et de l’argent. Rien de plus
égarant ou affolant, d’autant
plus que ces images mouvantes ont un poids
kinesthésique important
|
|
«
Je prie les choses les choses
m’ont pris
elles
me posent, elles me donnent un
prix
je
prie les choses, elles comblent
ma vie
c’est
plus « je pense » mais
« j’ai » donc je
suis
j’envie
ce que les autres
ont
je
crève de ce que je
n’ai pas
le
bonheur est
possession
les
super marchés mes temples
à moi
»
Goldman
Jean-Jacques, « Les choses
», 2001, album Chansons pour
les pieds
|
|
|