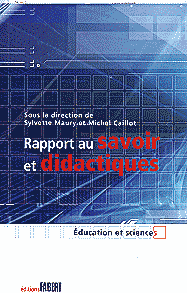PLAN
DU SITE
|
Rapport au
savoir et didactique
sous la direction de
Sylvette Maury et Michel Caillot
Col. Education
et sciences. Editions Fabert
(2003)
ISBN: 2 907 164 65
1 (20
€)
|
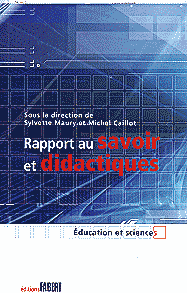
|
Dernière de
couverture
|
|
L'expression
du "rapport au savoir" est aujourd'hui
largement répandue dans les milieux
francophones de l'éducation,
à travers les discours des
chercheurs, des professionnels, voire des
politiques. Cette notion
intéresse les travaux des
didacticiens des disciplines car elle se
trouve au coeur des processus
d'apprentissage de
élève.
Le but
de l'ouvrage est de présenter
à la fois les diverses
entrées (sociologique,
psychanalytique, anthropologique)
concernant cette notion
élaborée dans le monde
francophone mais souvent mal
vulgarisée, et l'usage qui peut en
être fait par les chercheurs en
didactique.
Le
chapitre introductif retrace
brièvement l'histoire de
l'émergence du concept dans les
didactiques et illustre son utilisation
dans ce champ. On trouve ensuite les
contributions d'auteurs français et
québécois, a l'origine des
théorisations de la notion ou ayant
largement contribué à son
développement : C.
Blanchard-Laville, B. Charlot, Y
Chevallard, P. Jonnaert et M. Larochelle.
Leurs textes est complétés
par celui de P. Clanché, qui
apporte le regard de l'anthropologue de
l'éducation,
Cet
ouvrage devrait inéresser
particulièrement les formateurs,
les maîtres en formation ou en
exercice ainsi que les chercheurs en
éducation et les didacticiens des
diverses disciplines. II devrait
égaiement constituer un ouvrage de
référence sur le"rapport au
savoir" pour les étudiants en
sciences de l'éducation.
|
Éducation
et
science
Une
collection dirigée par Sylvette
Maury
Agrégée
de mathématiques, professeur
à l'Université des Sciences
et Techniques du Languedoc à
Montpellier, auteur de nombreux articles
en didactique des mathématiques,
Sylvette Maury est aujourd'hui professeur
de sciences de l'éducation à
la Sorbonne, Université Rene
Descartes - Paris 5 -
La
collection Éducation et science
s'adresse à tous les publics
intéressés par les
problèmes de l'éducation,
aux différents professionnels de
l'enseignement et de la formation, mais
aussi aux personnes désireuses de
mieux connaître et comprendre ces
problèmes. Les champs de
l'éducation et de la formation sont
vastes, aussi la collection pourra-t-elle
comprendre, à
côtéd'ouvrages traitant de
l'enseignement, d'autres qui concernent la
famille, le travail, les loisirs,
etc.
|
Sylvette Maury et
Michel Caillot
sont Professeur de sciences de l'éducation
à la Facultés des Sciences Humaines
et Sociales-Sorbonne (Université René
Descartes-Paris V). Ils sont respectivement
spécialistes de didactique des
mathématiques et de didactique des sciences
expérimentales et collaborent au sein du
laboratoire Éducation et Apprentissages
(EDA).
|
Table des
matières
|
Avant-propos
1. Quand
les didactiques rencontrent le rapport au
savoir, par
Sylvette Maury
et Michel Caillot
1.
Introduction
2. Au début
des didactiques
3. Autour des
nombres décimaux
3.1. Un nombre
décimal comme un couple d'entiers
3.2. Un
décimal = un entier!
4. Les didactiques
face aux « rapports au savoir
»
5. Approche
anthropologique des savoirs
6. Des rapports
personnels au savoir
6.1. Dimension
privée - dimension publique du rapport au
savoir
6.2. Le rapport au
savoir sur la foudre
7. Le rapport
à « l'apprendre »
8. Conclusion;
Références
bibliographiques
2.
La
problématique du rapport au
savoir
par Bernard
Charlot
1. Le rapport au
savoir: question ancienne, notion
nouvelle.
2. La
problématique psychanalytique le savoir
comme objet de désir
3. La
problématique sociologique: du social comme
position au social comme position, histoire et
activité
4. Le rapport au
savoir : une question pour la didactique ?
Références bibliographique
|
3.
Rapport au
savoir et socialisation à la cité
scientifique,
par Marie Larochelle
1. De la mise en
boîte des vivants
2. La
classification : une question
d'ontologie
ou de
négociation ?
3. De la mise en
boîte d'un objet hybride
4. De la mise en
boîte des élèves
5. Conclusion;
Références
bibliographiques
4.
Approche
anthropologique du rapport au
savoir
et
didactique des
mathématiques,
par Yves
Chevallard.
1. Rapports
personnels, rapports institutionnels
2. La
relativité institutionnelle de la
connaissance
3. Formation,
disciplines, contre-assujettissements
4. Pathologie du
rapport à la connaissance
Références
bibliographiques
5.
Perspectives
curriculaires contemporaines et changements des
rapports aux savoirs,
par Philippe Jonnaert
1.
Introduction
2. Clarifier le
concept de compétence
3. Clarifier un
paradigme épistémologique
4.
Compétences et
socioconstructivisme
5. De nouveaux
rapports aux savoirs
6. Conclusion
Références
bibliographiques
|
6. La didactique
et les rapports aux savoirs le point de vue de
l'anthropo-didactique,
par Pierre Clanché
1. Didactique et
« rapport au savoir »
2. Leffet «
âge du capitaine » : quel est le rapport
?
3. Lancrage
anthropologique du didactique : l'arrachement
.
4. Rapport au
savoir : croyance ou erreur ?
5. Bi-focalisation
de la scène
6. Culture,
contexte et coutume
7. La
situation
8.
Ouvertures
Références
bibliographiques
7.
Rapport au
savoir et approche clinique des pratiques
enseignantes, par Claudine
Blanchard-Laville
1.
Parcours
2. Transfert,
contre-transfert et transfert didactique
3. Franck et
Mélanie
4. Stéphanie
ou les débuts d'un professeur de sciences
physiques en collège
Références
bibliographiques
|
Deux
passages
|
<<Voilà
l'enseignant qui vient se prêter au jeu de la
demande, demande de savoir, s'entend ; mais, lui
sait bien confusément qu'au-delà de
cette demande de savoir lui sont adressées
par la même occasion tout un tas d'autres
demandes imaginaires; toutes ces demandes, il sait
aussi, sans le savoir vraiment, qu'elles ne lui
sont pas véritablement adressées,
mais adressées à travers lui au sujet
en tant qu'il a pris la place du « sujet
supposé savoir » ; il sait bien aussi
que ces demandes concernent l'élève
en tant que sujet qui réactualise dans
l'espace pédagogique des demandes
façonnées, selon son mode à
lui, par son passé et en particulier,
structurées selon le schéma
prototypique de ses demandes anciennes aux imagos
parentales.
Tout en pressentant
cela, il va s'efforcer de répondre ; il est
payé pour cela : il va restituer tout ce
qu'il sait, de son mieux ; il va même dire
quelquefois qu'il se « tue » à
cette tâche de restitution, mais ce faisant,
il va en profiter à son tour pour glisser
subrepticement et implicitement un « puisque
je vous donne tout, tout ce que j'ai, puisque vous
m'épuisez en me vidant de toute ma
substance, alors en retour, vous allez bien
m'aimer, tous, vous allez m'aimer et vous allez
vous laisser séduire par moi ». Et
voilà que chemin faisant, un peu à
son insu, il enferme l'autre-élève
dans un contrat imaginaire très complexe
où l'on ne sait plus bien à la fin
qui demande quoi et à qui ...
De plus, ne pouvant
en vérité jamais satisfaire la
demande de l'autre, dont on a vu qu'elle
était exorbitante, à vouloir remplir
tous les manques laissés par toutes les
demandes précédentes insatisfaites,
l'enseignant va se laisser charger imaginairement
d'un savoir qui dépasse largement son savoir
réel et qu'il ne possède pas plus que
les autres : c'est le savoir à lui
supposé. C'est ce savoir-là qui va
asseoir son autorité, alors que son savoir
réel lui donne tout juste, comme l'exprime
Octave Mannoni, « un pouvoir défini
», pouvoir de noter par exemple, de
sanctionner, de sélectionner.
Parallèlement, commence pour lui
l'insupportable situation d'incomplétude
narcissique : il va se laisser envahir du doute,
doute sur lui, sur son savoir, sur son image, du
doute de n'en pas savoir assez, de n'avoir pas ce
savoir que sûrement les autres enseignants ne
manquent pas d'avoir ; ceux de la classe voisine,
ou mieux, de la classe au-dessus ou encore mieux du
cycle au-dessus. Voilà les collègues
chargés à leur tour imaginairement de
posséder cet en-plus qui manque à
tout le monde. Et voilà engagé le jeu
indéfini de la balle qui poursuit de main en
main une ronde imaginaire.>>p.150-151.
Chapitre: Rapport au savoir et approche clinique
des pratiques enseignantes. Claudine
Blanchard-Laville
|
|
<<Se former,
c'est se discipliner : l'offre de formation est
offre de discipline. La chose doit être
entendue aussi en un sens du mot qui est une
extension de son sens premier : si «
discipline » désigne très
tôt la mortification corporelle que s'impose
le clerc (pour se former...), il signifie aussi, en
ancien français, massacre, carnage, ravage,
calamité. De fait, l'assujettissement aux
disciplines d'une institution de formation peut
avoir sur les formés des effets
profondément déstabilisants. En bien
des cas, ainsi, les assujettissements auxquels x se
trouve soumis dans l'institution de formation
tendent à lui imposer des rapports qui,
à court terme, entrent en conflit avec ses
propres rapports personnels. Toute personne est la
résultante d'assujettissements à une
multitude d'institutions en lesquelles elle a
rencontré diverses oeuvres ; ces
institutions dont elle a été le sujet
ont peu à peu, au fil des années,
construit sa « personnalité », en
lui inspirant ses manières d'être et
ses manières de voir - ses rapports
personnels. La personne émerge du
maelstrôm de ses assujettissements
passés et présents, sans se
réduire jamais à aucun d'eux, on l'a
déjà noté, même si tel
d'entre eux apparaît dominant en tel type de
situations. Ce serait donc une lourde erreur de
croire qu'un élève, par exemple, est
ou devrait être le sujet docile de l'oeuvre -
français, mathématiques, anglais,
sciences économiques et sociales, etc. -
dans laquelle le professeur a reçu mission
de le faire entrer. D'autres assujettissements,
exogènes, antérieurs, seront
peut-être vécus par lui comme plus
vitaux, ou simplement comme de meilleurs garants de
l'intégrité et du
développement de sa personne, tandis que les
assujettissements imposés par la formation
scolaire seront ressentis, ponctuellement ou
globalement, comme menaçant son
intégrité personnelle - chose
particulièrement sensible en milieu
populaire.>> p.90-91 Approche
anthropologique du rapport au savoir et didactique
des mathématiques. Yves
Chevallard
|
Commentaires
|
Livre
particulièrement intéressant dans la
mesure où il montre bien la
complexité du rapport au savoir et donc de
la didactique et de la construction des
connaissances.
Il
présente diverses perspectives de ce rapport
au savoir, montrant la richesse de ce concept mais
également la diversité de ces
approches possibles. On lira avec
intérêt l'essai de
mathématisation des relations, interactions
d'un élève avec l'objet du savoir par
Yves Chevallard. La difficulté ensuite est
de ne pas négliger l'une des approches
énoncées, car la tentation, bien
sûr, est de le faire (comme moi en
présentant seulement deux passages de ce
livre!).
|